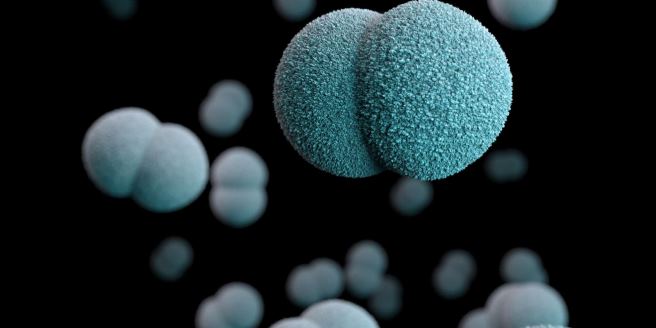Accueil » Accident médical » L’indemnisation de l’infection nosocomiale
On la définit en général comme étant une infection contractée au cours d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
Les infections associées aux soins ou hospitalières sont un véritable fléau sanitaire. Elles concernent 6 à 7% des patients hospitalisés, soit un patient sur vingt. De même environ 5 000 décès sont attribuables aux infections nosocomiales chaque année en France.
Dans le monde les infections nosocomiales sont l’une des principales causes :
- D’hospitalisation prolongée ;
- Et de mortalité dans les pays développés.
On estime que plus de 7 millions de patients développent une infection nosocomiale chaque année dans le monde, avec un taux de mortalité d’environ 25%.
La réparation de l’infection nosocomiale est donc d’une importance capitale.
J’aborde dans cet article le droit à indemnisation de l’infection nosocomiale des personnes qui en sont victimes.
Que sont les infections nosocomiales ?
Définitions
Il n’existe aucune définition légale ou jurisprudentielle de l’infection nosocomiale. On dit généralement qu’une infection est dite nosocomiale et associée à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins si elle survient :
- Au cours ou à l’occasion d’une prise en charge d’un patient ;
- Et si elle n’était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge.
Lorsque l’état infectieux lors de la prise en charge n’est pas connu, un délai d’au moins 48 heures est accepté pour dire qu’il s’agit d’une infection associée à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
Exemples d’infections nosocomiales :
- La bactérie Pseudomonas aeruginosa est fréquemment une cause d’infection nosocomiale.
- En cas de pose de sondes urinaires, les infections urinaires sont assez fréquentes.
Définition de la circulaire n° 263 du 13 octobre 1988 du décret 88-657 du 6 mai 1988.
Cette définition incluse dans la circulaire 263 du 13/10/88 a le mérite d’être plus précise, toute maladie provoquée par des micro-organismes :
- Contractée dans un établissement de soins par tout patient après son admission. Soit pour hospitalisation, soit pour y recevoir des soins ambulatoires ;
- Que les symptômes apparaissent lors du séjour à l’hôpital ou après ;
- Que l’infection soit reconnaissable aux plans clinique ou microbiologique, données sérologiques comprises, ou encore les deux à la fois.
Cela concerne aussi le personnel hospitalier en raison de son activité.
Où contracte-t-on une infection nosocomiale ?
Une infection nosocomiale est une infection contractée :
- Soit dans un établissement de santé public comme un hôpital
- Soit dans un établissement de santé privé, une clinique ou bien un cabinet médical.
Quand peut-on considérer une infection comme nosocomiale ?
Le délai après admission
On considère une infection comme nosocomiale si elle était absente au moment de l’admission du patient à l’hôpital. Elle est donc contractée pendant les soins. On envisage, en général, cette possibilité lorsque l’infection se déclare 48 heures après l’admission.
Délai pour les infections au site opératoire
Les infections en site opératoire sont nosocomiales en cas d’apparition dans les 30 jours suivant l’opération.
Le délai pour les prothèses ou implant
Lors de la pose d’une prothèse ou d’un implant ce délai est d’un an.
Voir aussi :
La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, dite Loi Kouchner : réforme de l’indemnisation des infections associées aux soins
La loi du 4 mars 2002 a uniformisé les régimes. Elle a supprimé la distinction entre responsabilité civile et responsabilité administrative. En effet, avant cette loi, l’indemnisation reposait uniquement sur la jurisprudence.
Ce système était confus puisque les solutions différaient selon le lieu où l’infection était déclarée. Ainsi :
- Dans un établissement privé elle relevait du juge judiciaire
- Dans un établissement public relevant du juge administratif.

Qui indemnise le patient victime ?
Malgré la loi Kouchner, le régime d’indemnisation du préjudice causé aux victimes n’est pas simple. En effet, il faut distinguer selon les situations :
- Les infections nosocomiales survenues dans un établissement de santé ;
- Celles causées par un médecin ou en cabinet médical.

Réparation de la victime de l’infection survenue en établissements de santé
La présomption de responsabilité des établissements de santé
Depuis la loi Kouchner, la victime n’a plus à apporter la preuve d’une responsabilité de l’établissement de santé pour obtenir une indemnisation. En effet, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostics ou de soins, sont présumés responsables des infections nosocomiales survenues après les 48 heures de l’admission du patient et ce, jusqu’à 30 jours après la sortie du patient.
L’indemnisation des infections nosocomiales par l’ONIAM – CCI
Aussi, la loi du 30 décembre 2002 a voulu décharger les assureurs. Elle a attribué l’indemnisation des infections nosocomiales à la solidarité nationale. C’est l’ONIAM qui intervient depuis cette date pour l’indemnisation les cas de graves préjudices. Il s’agit en quelque sorte d’un règlement amiable des accidents médicaux.
Cependant, pour que l’ONIAM prenne en charge l’indemnisation il faut que l’infection soit considérée comme grave.
Qu’est-ce qu’une infection grave ?
L’infection nosocomiale est grave dans l’un des cas suivants :
- Il faut qu’elle ait causé à la victime un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique égal ou supérieur à 25%.
- Ou bien qu’elle soit à l’origine d’une incapacité temporaire de travail supérieure à six mois consécutifs. Ou bien non consécutifs sur une période de douze mois.
- À titre exceptionnel. Si la victime est définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait auparavant.
- À titre exceptionnel. L’infection est grave si elle cause des troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence de la victime. Troubles qui peuvent être aussi économiques.
L’infection nosocomiale moins grave
Pour les infections nosocomiales les moins graves, l’ONIAM n’intervient pas. Mais on présume toujours la responsabilité de l’établissement de santé. Ce qui signifie que la victime n’a pas à prouver la responsabilité. C’est alors l’assureur de l’établissement de santé qui prend en charge l’indemnisation des préjudices causée par l’infection dans l’établissement.
En cas d’infection moins grave, plusieurs voies pour obtenir l’indemnisation
Dans les cas où l’ONIAM n’intervient pas, la victime peut transiger avec l’assureur de l’établissement de santé. Toutefois, la victime de l’infection nosocomiale se trouvera seule face à un assureur. C’est une situation de déséquilibre, victime étant alors en position de faiblesse. La victime a donc véritablement intérêt, d’être assistée par un avocat.
Le plus souvent, il est plus intéressant pour la victime de saisir le tribunal. Dans ce cas, le choix du tribunal compétent dépend de la nature de l’établissement où a été contractée l’infection. Ainsi :
- Si la victime a contracté l’infection dans un établissement public de santé. L’action judiciaire dans ce cas sera portée devant le juge administratif.
- Dans le cas où l’infection nosocomiale est contractée dans un établissement de santé privé. Il peut s’agir ici d’une clinique, un cabinet médical ou un médecin libéral. L’action de demande d’indemnisation sera alors portée devant le juge judiciaire.
La victime peut également saisir la CRCI. Ce sont les Commissions de Conciliation et d’indemnisation. Elle peut le faire, soit dans le cadre d’une conciliation, soit dans un cadre amiable. Encore une fois un l’assistance avocat des victimes d’accidents médicaux est presque indispensable.
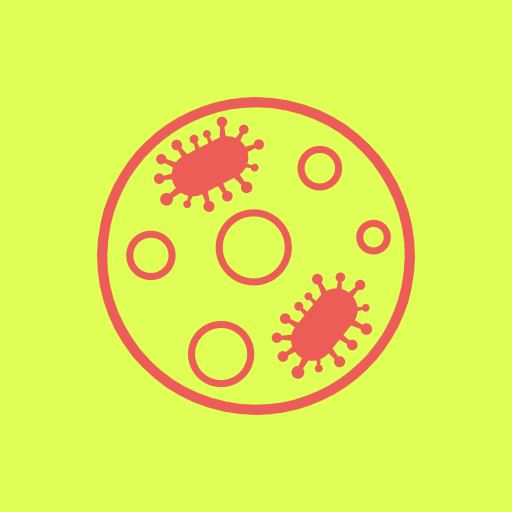
Le cas où un médecin ou en cabinet médical est à l’origine de l’accident
Dans le cas où un médecin ou un cabinet médical sont la cause de l’infection nosocomiale. C’est-à-dire hors établissements de santé comme hôpitaux ou cliniques. Le régime est alors moins favorable pour les victimes. En effet, il n’y a dans ce cas plus de présomption de responsabilité. Par conséquent, il faudra que la victime démontre la faute du professionnel de santé.
Précisons que les proches de la victime peuvent aussi être indemnisés pour leurs préjudices.
Il importe peu la provenance de l’infection :
- Elle peut provenir d’une bactérie extérieure au patient, ce qu’on appelle une infection nosocomiale exogène.
- Ou bien d’un germe du patient lui-même, c’est-à-dire qu’elle soit endogène.
Dans les deux cas la responsabilité de l’établissement de santé existe. Le droit à indemnisation de la victime de l’infection nosocomiale est par conséquent le même.
Covid-19 et infections nosocomiales
En février 2021, la Covid-19 est la première cause d’infection nosocomiale dans les hôpitaux français.
En effet, depuis la pandémie, de nombreuses personnes se sont rendues dans les hôpitaux pour une intervention. Pendant le séjour elles ont contracté le virus. Il a pu en résulter le décès du patient infecté.
Les ayants droit de la personne décédée dans ces conditions, peuvent envisager un recours et demander indemnisation. Ce recours serait contre l’établissement hospitalier.
Voir aussi à ce sujet : Accidents vaccination Covid-19
Sur la définition juridique de l’infection nosocomiale
Vidéo par Lionel COLLET ancien Professeur des universités et Praticien hospitalier. Explication sur la définition jurisprudentielle des infections nosocomiales.
Contact : RSL Avocat indemnisation des accidents médicaux
Mon cabinet est dédié à l’assistance juridique des victimes de dommages corporels. Je défends les victimes qui veulent obtenir une indemnisation d’infection nosocomiale. Mon choix personnel est de m’engager uniquement aux côtés des victimes. Je ne défends jamais les compagnies d’assurances.
Je suis Avocate au barreau de Paris, diplômée et expérimentée en contentieux médical. J’accompagne les victimes dans toutes les démarches. Mon but est d’obtenir la meilleure indemnisation possible des préjudices subis.
Le cabinet est situé à Paris, dans le 17e arrondissement. Vous pouvez me contacter à l’aide des formulaires d’information et de rendez-vous.

Ou bien par téléphone au +33 (0) 1 84 74 45 75 ou par courriel : contact@rsl-avocat.com. Je vous répondrai dans les plus brefs délais.
En savoir plus sur les accidents médicaux
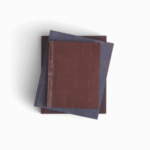
Indemnisation par l'ONIAM

Vaccination Covid

Indemnisation d'accident lié aux soins de santé
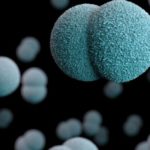
Infection Nosocomiale

Aléa Thérapeutique
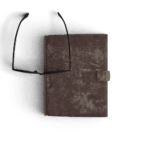
CCI ou CRCI : Les Commissions de Conciliation et d’indemnisation

Myocardite après vaccination Covid : l’Indemnisation par l’Oniam

Jurisprudence en Accidents Médicaux

Minimiser les risques d'accident lors des soins
Lire ↗

Produits de Santé Défectueux